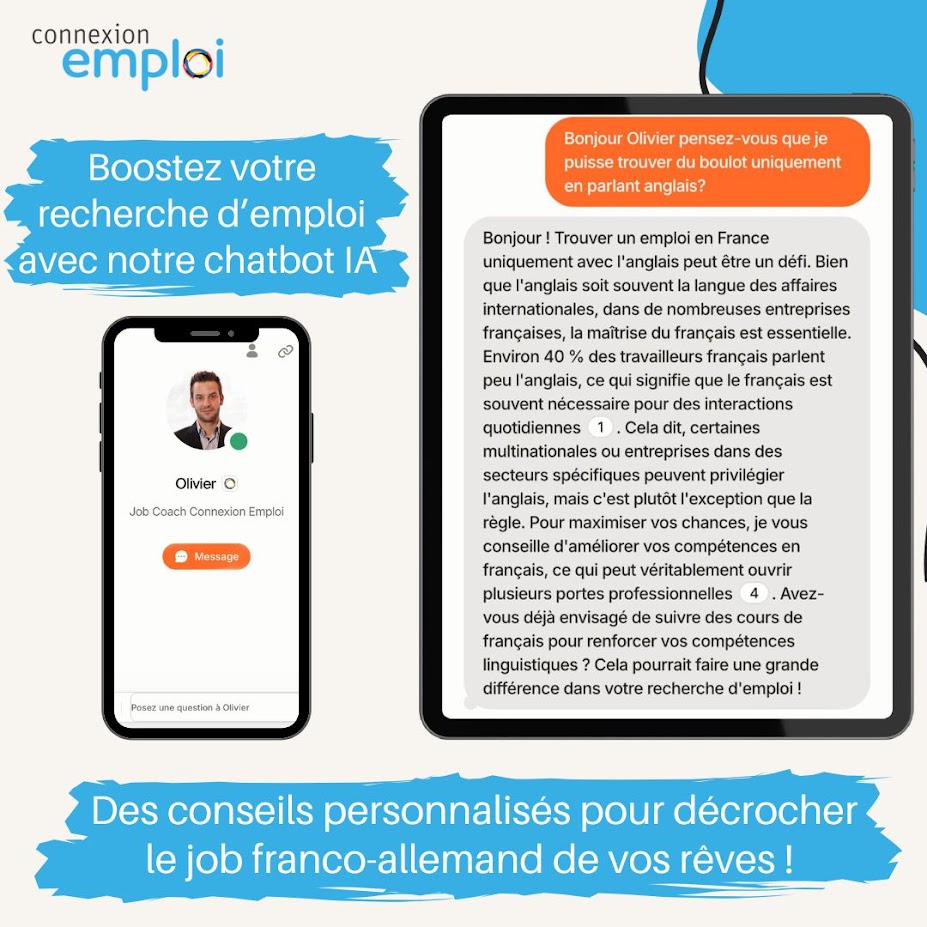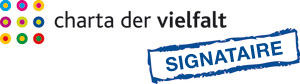J’ai quitté la France pour devenir infirmière en Allemagne : un choix payant à la retraite

Quitter la France pour devenir infirmière en Allemagne ? C’est le choix que j’ai fait il y a plus de 40 ans. Aujourd’hui, à l’âge de la retraite, je vous dévoile sans tabou combien je touche chaque mois, après une carrière complète dans le secteur hospitalier allemand. Salaire, conditions de travail, pension de retraite : voici mon témoignage concret pour celles et ceux qui envisagent de suivre le même chemin.
2. Les conditions de travail en tant qu’infirmière en Allemagne
3. Mon salaire tout au long de ma carrière
4. Ma pension de retraite aujourd’hui : chiffres et réalités

Je m’appelle Sophie, j’ai aujourd’hui 66 ans, et j’ai travaillé plus de 40 ans comme infirmière dans un hôpital public à Francfort, en Allemagne. Mon histoire commence en 1981, quand j’ai quitté la France à l’âge de 22 ans. À l’époque, le chômage des jeunes était élevé, et le secteur hospitalier allemand recrutait activement des infirmières étrangères. J’ai répondu à une annonce de l’Agence fédérale pour l’emploi allemande qui proposait un accompagnement pour s’installer et se former en Allemagne.
Je ne parlais pas un mot d’allemand, mais j’ai suivi un cours intensif de six mois. À ma grande surprise, j’ai vite été intégrée dans l’équipe soignante d’un hôpital universitaire. C’était un choc culturel, certes, mais aussi une opportunité professionnelle inespérée. Les débuts ont été difficiles, entre le choc culturel et la pression du métier, mais j’ai été entourée, formée et surtout, reconnue pour mes compétences. Ce premier pas a été décisif : il a posé les bases de quarante années d’une carrière stable, bien rémunérée et humainement riche en Allemagne.
Au fil des années, j’ai vu les conditions de travail s’améliorer : meilleures pauses, formation continue, primes de nuit, reconnaissance de l’ancienneté. En tant que salariée du secteur public, j’étais affiliée au système de retraite des fonctionnaires, ce qui a eu un impact majeur sur ma pension actuelle.

Travailler comme infirmière en Allemagne dans les années 80 n’était pas de tout repos. Les journées étaient longues, le rythme soutenu, et les équipes parfois en sous-effectif. Mais l’un des points positifs, c’est qu’on bénéficiait d’une vraie stabilité de l’emploi et d’un système de retraite solide. Lorsque j’ai commencé à exercer en tant qu’infirmière en Allemagne, j’ai rapidement compris que les attentes étaient élevées, mais aussi que le cadre de travail était structuré. Les horaires étaient clairs, les responsabilités bien définies, et surtout, j’étais intégrée dans une équipe où la collaboration avec les médecins était basée sur le respect. En tant qu’infirmière dans un hôpital public, je bénéficiais dès le départ d’un contrat de la fonction publique, encadré par les conventions collectives appelées TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). Ces conventions fixent les salaires, les primes, les congés et les droits à la retraite, ce qui garantit une grande stabilité.
Le rythme était soutenu, bien sûr, surtout dans les services d’urgence ou de soins intensifs. Mais à la différence de la France, j’ai rapidement remarqué qu’en Allemagne, on faisait tout pour éviter le burn-out du personnel soignant : on limitait les heures supplémentaires, on encourageait la formation continue, et surtout, on valorisait l’ancienneté avec des augmentations automatiques. J’ai eu accès à des séminaires réguliers, des cours de spécialisation (notamment en gériatrie et soins palliatifs), pris en charge par l’hôpital.
Travailler dans le secteur public allemand signifiait aussi bénéficier de droits sociaux solides : 30 jours de congés par an, une couverture santé complète, et la possibilité de prendre des congés formation ou parental tout en conservant ses droits à la retraite. C’est ce modèle structuré et protecteur qui m’a permis de bâtir une carrière durable, sans jamais craindre pour mon avenir professionnel.
Depuis 2001, les infirmiers sont aussi intégrés dans le cadre des conventions collectives de la fonction publique (TVöD), ce qui garantit des augmentations régulières et une protection sociale complète. C’est un des avantages majeurs du métier d’infirmière en Allemagne par rapport à la France.

Lorsque j’ai commencé à travailler comme infirmière en 1982 à Francfort, mon salaire brut mensuel était de 1 800 Deutsche Mark, soit environ 920 € en conversion actuelle. Cela peut sembler modeste, mais à l’époque, avec un logement d’hôpital et un coût de la vie raisonnable, je vivais correctement, et surtout, je pouvais envoyer de l’argent à ma famille en France. Ce qui m’a tout de suite rassurée, c’est que les augmentations étaient automatiques tous les deux ans grâce au système de paliers dans la convention collective TVöD.
Dès les années 90, mon salaire a commencé à grimper plus sensiblement. Avec mes années d’expérience, des responsabilités supplémentaires (comme devenir référente d’unité), et quelques spécialisations, j’ai franchi la barre des 2 500 € bruts. En 2005, après plus de 20 ans d’ancienneté, je gagnais environ 2 900 € bruts, et ce montant continuait d’augmenter grâce à une grille salariale très transparente.
À la fin de ma carrière, en 2020, mon salaire brut mensuel atteignait 3 200 €, soit environ 2 150 € nets. Ce montant comprenait également des primes de nuit, des majorations pour les week-ends, ainsi que des compensations pour les heures supplémentaires. J’étais affiliée à la VBL, un régime complémentaire réservé au personnel public, ce qui m’a permis de constituer une retraite plus confortable.
Ce que j’ai apprécié tout au long de ma carrière, c’est la clarté du système salarial allemand, où les paliers sont publics, les augmentations garanties, et les efforts récompensés. À aucun moment je n’ai eu à négocier dans le flou ou à justifier chaque centime : tout est encadré et prévu à l’avance, ce qui permet de se projeter avec sérénité.

Aujourd’hui, à 66 ans, je touche chaque mois une pension nette de 1 980 €, versée directement sur mon compte bancaire allemand. Cette somme est le résultat de plus de 40 années de cotisations dans le système public de retraite allemand. Elle comprend deux volets : d’un côté, la pension de base versée par la Deutsche Rentenversicherung, qui représente environ 1 580 € nets ; de l’autre, une retraite complémentaire issue de la VBL d’environ 400 € nets, à laquelle j’ai cotisé tout au long de ma carrière en tant qu’employée du service public hospitalier.
Ce montant me permet de vivre confortablement dans une ville moyenne comme Mayence. Je suis locataire d’un appartement de 60 m² dont le loyer est de 680 € charges comprises. Mes autres dépenses (alimentation, transport, loisirs, assurance santé) sont largement couvertes par ma pension. De plus, en tant que retraitée affiliée à la Krankenkasse (caisse d’assurance maladie publique), je continue à bénéficier d’une couverture santé de qualité, sans avoir à payer de cotisation supplémentaire.
En Allemagne, les pensions sont versées à vie, sans condition de ressources, et elles sont revalorisées chaque année en fonction de l’inflation et de l’évolution des salaires. En 2023, la hausse a été de 4,39 % à l’Ouest du pays, par exemple. Je bénéficie aussi de réductions pour les transports en commun, d’abonnements culturels pour seniors, et d’un système de santé très accessible. Ce niveau de retraite, supérieur à la moyenne française pour les infirmiers, est selon moi la récompense d’un système prévoyant, bien géré et respectueux de ses travailleurs.
En savoir plus:

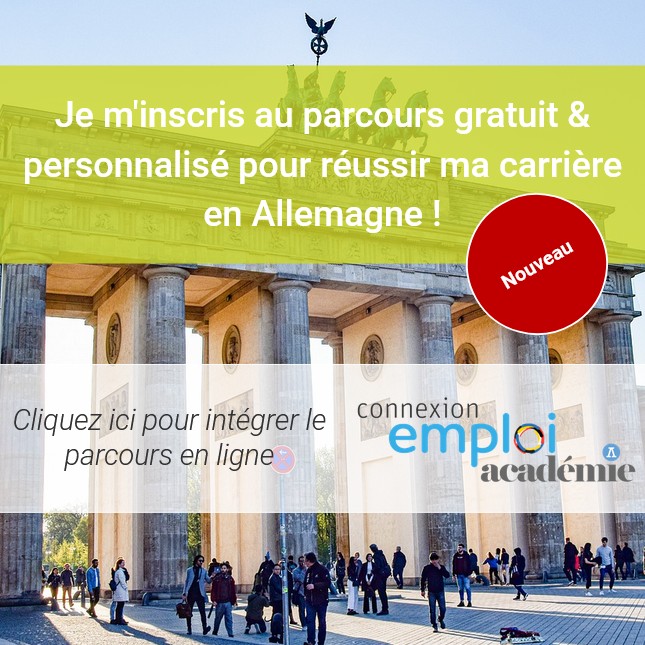

 Fr
Fr De
De En
En